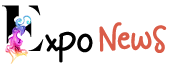La nuit est l'entre-deux dans lequel le flou entre le tôt et le tard peut être perçu à travers la perception (subjective ?) de l'obscurité. Le premier voyage en solo à Graja, un quartier de l'extrême sud de Sao Paulo, est tiré par la mémoire. Voitures, Avenida Belmira Marin, gauche, droite. Une mauvaise rue et le sentiment de "voyons où ça va". C'était droit, vers leâ là devant l'endroit où l'avenue se termine dans l'eau, dans le bac qui traverse l'obscurité vers l'île Bororée. Ce qui importe ici n'est peut-être pas l'histoire ou l'ordre des événements, mais la manière dont nos passages, ou ce que nous traversons, définissent nos permanences dans la ville. Comment le fait d'aller, d'être, d'interagir ou ensuite, de rester définit l'endroit où nous voulons aller. Dans ce processus de transit, nous trouvons quelque chose de commun : les gens.
Alexandre Orion est un artiste - ou un intervenant urbain ?
â qui regarde la ville et remarque le contraste entre ses 11 millions d'habitants et les espaces vides qui la composent. Les œuvres "Ossàrio" (2010) et "Metabiàtica" (2013) sont des exemples de la manière dont la métropole dominée par le gris est établie comme un vice et une vertu pour ceux qui l'habitent. "Nous tissons un réseau affectif les uns avec les autres. Il est difficile d'aller quelque part et de créer une relation étroite avec un lieu ou un mur. Vous êtes médiatisé par une interaction. C'est dans ce lieu que l'on retrouve le souvenir de celui qui nous a amené là ou de ce que l'on a trouvé en chemin. Vous tissez des conversations et la portée de la ville augmente, elle s'étend", dit Orion.
Alexandre Orion a créé l'œuvre "Ossârio" (2006) dans la suie des murs du tunnel Max Feffer, à SP
La rencontre avec l'autre est la base de l'action dans la ville. C'est cette vieille histoire que notre espace se termine quand celui de l'autre commence. Le problème, ou peut-être la richesse, c'est que la rue est faite des autres. Choisir de travailler dans l'espace public, c'est aussi regarder les gens et leur faire percevoir l'espace et le revendiquer comme un lieu :
"Je ne voulais pas que d'autres graffeurs me disent ce que je devais faire et comment je devais le faire, si j'étais bon ou pas. En fait, je voulais que les gens dans la rue le fassent. Donc, ma liberté n'a pas pris fin avant que je ne la trouve, chez des particuliers. Il n'y a rien qui soit vraiment toi, parce que c'est pour tout le monde. Quand on fait quelque chose dans la rue, on se rend compte qu'il ne sert à rien d'avoir des idées préconçues sur ce que l'on veut y mettre. Mon travail est basé sur la lecture des significations de la ville et sur la perception que, parmi elles, l'essentiel est que les gens soient là. Un mur n'est qu'un mur, mais selon l'endroit où il se trouve, la signification que les gens lui attribuent, le décor qu'on y trouve et l'environnement dans lequel il se trouve, sa signification change complètement".
La suie a, également, été utilisée dans les œuvres "Pollution on the wall" (2012), réalisées au Brésil et à l'étranger
L'intervention urbaine est comme une écriture dans laquelle le mur est le papier, la ville est le décor et les gens sont les personnages régis par une intrigue qui implique tout le monde. La construction de ce lieu, qui s'exprime et se laisse exprimer, donne une âme à la ville et est un jeu entre le discours de qui crée et la lecture de qui voit. La communication ne se produit et ne trouve sa permanence ou son agitation que si nous nous permettons de regarder et d'être regardés. Dans une ville où l'échelle humaine a été réduite et où les regards ne se croisent pas de peur d'être lus, ce contact visuel est peut-être le premier pas pour (ré)occuper le temps et l'espace publics. Peut-être manquons-nous d'indiscrétion et avons-nous trop peur.
Malheureusement, l'œuvre a été effacée à coups de jets d'eau par le Département du nettoyage public de SP
"La plupart des gens vivent dans la peur. Je crois que la rue est un endroit menaçant pour tout le monde. La plupart ne sont pas ouverts pour lire les informations que la rue fournit. Les gens vivent une routine mécanique dans laquelle la logique de l'automobile fait de la ville un lieu de passage. C'est oppressant. Vous allez d'un point à un autre, mais vous n'êtes jamais vraiment là. L'art urbain vient questionner cela et la présence de l'artiste, pendant le processus de travail dans la rue est, déjà, un grand événement. Je dis, souvent, que le graffiti n'est pas une œuvre en soi : il est performatif avant d'être. Celui qui passe par un lieu et voit quelque chose en cours de réalisation qui est tourné vers la rue, se rend immédiatement compte que cet espace est appelé : "Hé ! ici on peut être occupé ! Intervenir, c'est potentialiser un sens, le subvertir ou le re -signifier. Toute manifestation dans ce sens revendique l'espace, y compris les graffitis !"
Dans une performance pan, ce qui compte, c'est ce qui s'y imprime, plus que l'intervention, l'acte et l'invitation à intervenir. Lorsqu'un mur reçoit des graffitis, il commence à contenir un discours, un découpage de la ville qui stimule le doute. Tout dépend de la profondeur avec laquelle la personne qui passe par là est prête à s'arrêter, à entrer et à se fondre dans les veines cachées que propose la ville. À Grajaà, par exemple, dans l'œuvre Apreensao (2014), un enfant géant détruit des maisons, dans un discours aussi puéril que raffiné.
Une réflexion sur l'occupation de l'espace
"Quelque chose me rappelait à Grajaàº. Ma dernière intervention était un panneau de 15 x 32 m au CEU Navegantes. Ce n'est pas un mur qui donne sur la rue, mais pour un ensemble de maisons, pour le quartier. Ce qui importe ici, ce n'est pas tant le lieu, mais le discours placé et la manière dont il dialogue avec l'espace. Quand je faisais l'intervention, un type m'a demandé : "Mais est-ce qu'elle plaisante ? Parce que pour moi, on dirait qu'elle détruit les maisons".
La dichotomie est le thème de l'intervention "Apreensào", une composition croisée, mais non antagoniste, de jeu et de destruction ; d'innocence et d'inconséquence ; de faire pour vouloir et de vouloir faire. Le scénario, qui se concrétise dans la réalité avec les fréquentes expropriations dans la région, montre un enfant jouant avec des petites maisons. L'image elle-même est innocente. Mais si nous nous permettons de regarder à nouveau, l'enfant joue en fait avec les petites maisons. Le jeu passe par la destruction, car il est réel. Les maisons ne sont pas non plus celles des blocs pour enfants. Ils dépeignent exactement la texture de la périphérie avec ses briques apparentes, ses dalles, ses pièces, sa cuisine et les personnes dans les maisons.
Ville, population et imagination : la série "Metabiotic" (2014) est un regard poétique sur des situations de PS
Ce qui est fantastique, ce sont les proportions. Le panneau montre la figure d'un enfant géant qui semble être sorti d'un film de fiction ou de l'imagination de l'artiste. Assis dos à son jeu-destruction, le Grajaà, il est là comme s'il ne se souciait pas de ce qui se passe autour de lui. Elle n'est pas là pour détruire, mais ne prendra pas la peine de le faire, au cas où l'interaction de la pièce irait dans ce sens. En même temps, elle fait face à toutes les fenêtres voisines, dans une position d'insouciance, presque d'inconséquence, d'ouverture aux badauds. Elle démolit une maison, joue avec une autre jusqu'à ce que la prochaine étape soit peut-être de la détruire.
Quant aux interventions, Orion dit qu'elles sont "des métaphores de l'humain". L'enfant représente cela, car nous passons toute notre vie en tant qu'enfants. On apprend qu'on ne peut pas mettre son doigt dans la prise, mais d'un autre côté, on fait une série de choses qui sont extrêmement nuisibles. Lorsque la discussion sur la durabilité s'est intensifiée ces dernières années, j'ai pensé à l'insoutenable dans une perspective où nous avons traité le sujet de manière schizophrénique, car nous ne sommes pas durables. Les êtres humains sont mal préparés à se gérer eux-mêmes et, a fortiori, à gérer les autres. La présence de l'enfant apporte, également, l'idée de continuité et de finitude de l'être humain. Il est amusant de penser à cet enfant modifiant l'urbanisme de la ville, déplaçant les maisons dans une activité ludique par opposition à la logique adulte de manipulation du monde. C'est un conflit que de penser dans les deux sens. Que construisons-nous réellement ?
Dans la série "Metabiotic", l'intervention artistique et la réalité se confondent dans la beauté de la métropole
Le ton du message que l'on veut faire passer continue de se construire dans le matériau même utilisé. L'artiste-intervenant a utilisé une technique qui consiste à mélanger de la peinture acrylique incolore avec un pigment principal. Ce qui est intéressant, c'est que ce pigment est composé de suie prélevée dans la ville. Le concept est le même que celui utilisé dans le projet "Ossàrio" (2010). Ces particules, recueillies dans les tunnels de Sao Paulo, ont fait partie d'œuvres sur les murs du monde entier. Celle de Grajaà est la première intervention murale réalisée dans la ville avec cette technique.
"On peut, alors, dire que les murs ou même les galeries souterraines de la ville encadrent l'esthétisme, la couleur, le fantastique, le monumental et le mouvement du graffiti. Ils encadrent avant tout la construction d'un message, la pensée d'une génération, le discours et les manifestations de l'histoire présente. En bref : la mémoire, individuelle, collective ou partagée d'une ville de ceux qui la vivent et agissent sur elle. Si cette mémoire est une invention, qui saura combien d'entre elles transitent, se croisent, se révèlent, se rencontrent, restent et composent la ville comme un réseau de relations. Nous ne nous maintenons pas, nous ne sommes pas pérennes. L'idée de pérennité passe et se poursuit par l'autre et dans l'autre. Cela m'intéresse. La motivation est exactement dans l'idée que l'information que je peux produire ira à l'autre. D'où l'ampleur, l'effort pour atteindre l'autre", conclut Alexandre Orion.